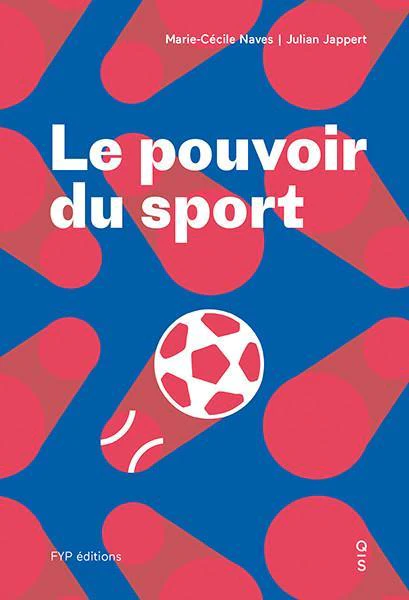
168 pages
EAN 13 : 978-2-36405-143-0
18 €

Coupe du monde 2018, Qatar 2022, Pékin 2022, Paris 2024 : du sport sous influences au sport qui influence.
Pourquoi faire du sport ? L’accessibilité au sport est-elle la même pour tous ? Quelles influences cette activité a-t-elle sur la société ? Que représente l’économie du sport aujourd’hui ? Peut-on concilier « développement durable » et « équipements sportifs des JO, coupes de monde, etc. » ? Le dopage et la corruption sont-ils inéluctables ? Le monde du sport est-il autonome ou sous l’influence des pouvoirs ?
Les enjeux du sport demeurent largement sous-estimés dans notre pays par la plupart des responsables politiques, des leaders économiques, des médias et des dirigeants sportifs eux-mêmes.
Dans « Le pouvoir du sport », Marie-Cécile Naves et Julian Jappert explorent tous les versants du sport. Ils montrent qu’il est tantôt paré de toutes les vertus, tantôt accusé de tous les maux, considéré comme trivial et secondaire. Il serait un facteur d’intégration et de vivre-ensemble, mais signifierait aussi le règne de l’argent-roi, de la corruption, du dopage. Tout ou rien. Ange ou démon. Comment expliquer ces deux visages antagonistes et incompatibles, et comment dépasser cette situation ?
• Les auteurs passent au crible les « valeurs supposées » du sport, son économie et ses dérives : le bénéfice santé de l’exercice physique, le rôle du sport et du spectacle sportif dans l’organisation sociale, l’émancipation et la cohésion sociale, le sport au travail, la marchandisation des sportifs, les dessous de l’organisation des événements sportifs, le dopage, la corruption, le communautarisme, la place des femmes, l’utilisation du sport comme levier diplomatique, etc.
• Ils décryptent les statuts et les modes de fonctionnement opaques des organisations sportives et leurs relations d’interdépendance (UEFA, FIFA, CIO, etc.). Ils en expliquent les formes juridiques et les financements.
• Ils mettent en évidence, entre autres, comment les grandes manifestations sportives ou les grands clubs, notamment de football, sont devenus un moyen de lobbying et un outil emblématique pour les pays souhaitant se positionner ou confirmer leur rang sur la scène internationale ou régionale. À travers l’organisation de compétitions majeures ou par leur investissement financier massif dans les disciplines sportives les plus populaires

Julian Jappert est directeur du think tank européen Sport et Citoyenneté et enseignant en droit du sport. Il a été juriste et lobbyiste auprès du groupe Canal+ et de la Commission européenne (unité sport).

Marie-Cécile Naves est politologue, chercheuse associée à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) et vice-présidente du think tank européen Sport et Citoyenneté.