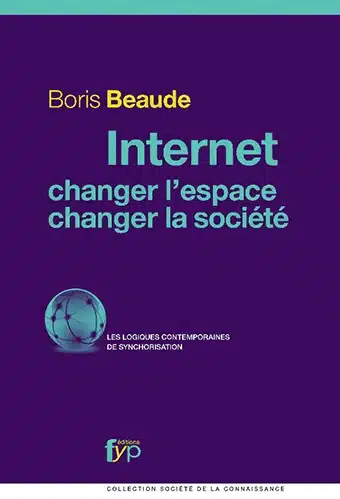

256 pages
ISBN 978-2916571690
20 €

Internet change notre rapport au temps, mais il transforme également en profondeur notre rapport à l’espace.
Aujourd’hui, internet n’est plus seulement un réseau informatique : c’est devenu un espace commun qui occupe une place croissante dans nos pratiques et se généralise à l’ensemble de notre existence. Facebook, Google, Youtube, les sites de vente en ligne et l’économie numérique sont devenus des éléments de notre quotidien.
Or, comme pour chaque espace, il est essentiel pour nos sociétés d’organiser et de le partager équitablement Internet.
De nombreuses questions se posent alors : qui organise cet espace, ? Qui crée internet ? Y-a-t’il une gouvernance d’internet ? Une régulation d’internet ? A-t-il une limite que l’on peut définir ? Peut-on le réguler, en bloquer l’accès comme on ferme une frontière ? En quoi un tel espace change la société dans son ensemble ?
Dans cet ouvrage, Boris Beaude, géographe expert de la dimension spatiale de la télécommunication, démontre que nous devons cesser de considérer Internet comme un monde virtuel et qu’il faut l’aborder comme un espace réel.
Grâce à cette approche innovante, il apporte une réponse claire à tous les enjeux d’Internet. Il analyse en profondeur les problématiques posées par l’hybridation de ce nouvel espace avec les territoires, telles que les questions de gouvernance, d’économie, de transaction, de droit, de propriété, de valeur ou de responsabilité.
Cet ouvrage apporte un éclairage inédit qui rend les enjeux d’Internet plus lisibles, pour pouvoir en saisir toutes les opportunités et en maîtriser les dérives.
Il fournit des clés pour agir individuellement et collectivement afin que, face à Internet, notre société puisse faire les bons choix et évite le mur vers lequel nous risquons d’aller à grands pas.
Sommaire
Introduction De quoi Internet est-il l’espace ?
Chapitre I Internet est un espace
1. De l’espace à la coexistence
2- Internet fait gagner de l’espace-temps
3- De quoi Internet est-il la virtualité ?
Chapitre II Se donner un espace commun
1- Les hauts lieux de synchorisation
2- Les vertiges de l’hypercentralité
3- Géographie de Chrome
Chapitre III Nouvel espace, nouvelle société
1- Quel est le prix de la gratuité ?
2- La capacité distribuée
3- La vulnérabilité généralisée
4- L’hybridation de l’espace
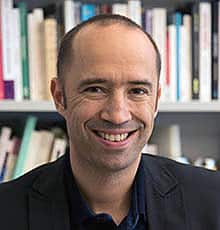
Boris Beaude est chercheur au sein du laboratoire Chôros de l’École polytechnique fédérale de Lausanne. Avant de rejoindre l’EPFL, il a obtenu un doctorat de géographie humaine de l’université Panthéon-Sorbonne et a été maître de conférences pendant huit ans à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po). Ses recherches portent sur les conditions spatiales de l’interaction sociale. Il s’intéresse en particulier à Internet comme espace de reconfiguration de la production, de l’information, de la transmission et plus généralement de la coexistence.